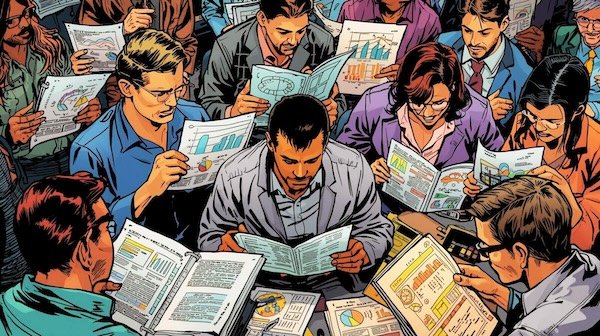Avis complet des élus CFDT CFE-CGC CGT UNSA SUD-SOLIDAIRES sur la politique sociale 2024
Conformément à nos prérogatives et dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, les élus CFDT CFE-CGC CGT UNSA SUD-SOLIDAIRES du CSE émettent le présent avis sur la politique sociale 2024 de l’UES AG2R.
Nous avons pris connaissance du rapport réalisé par le cabinet SECAFI, ainsi que des différents documents fournis par la Direction. Notre analyse porte sur les différents volets de la politique sociale mise en œuvre au sein de l’UES AG2R en 2024.
Emploi
Les élus notent avec satisfaction une augmentation des effectifs en CDI pour la deuxième année consécutive, marquée par une hausse de 2,3 % sur un an. Cette dynamique positive tranche avec les baisses enregistrées les années précédentes, avec 113 nouveaux postes en CDI (solde entrées / départs), principalement dans les métiers de la gestion et de la relation client, même si ce sont en majorité sur des postes de classe 2.
Dans certaines activités retraite, cette augmentation reste toutefois insuffisante au regard du recours prolongé aux heures supplémentaires, qui compensent un manque d’emplois pérennes. Les salariés recrutés ces trois dernières années vont finaliser leur montée en compétences progressivement. Nous serons attentifs aux remplacements des départs en retraite les prochaines années, afin que l’activité ne se retrouve pas à nouveau en tension.
Les recrutements dans l’UES ont atteint une volumétrie cible importante, avec 641 postes pourvus, dont 222 mobilités internes, 373 recrutements externes en CDI, et 46 titularisations.
Cependant, la hausse est inégalement répartie, car entièrement due à l’IRC. Les élus constatent une baisse de 1,8% des effectifs dans le GIE AG2R.
Cette disparité soulève des questions sur la cohérence de la stratégie RH à l’échelle groupe, les élus s’interrogeant sur la vision à moyen terme de l’entreprise en matière d’emploi, ainsi que sur les perspectives professionnelles offertes aux salariés dans les différentes filières.
Malgré une augmentation globale des effectifs de 5,6% entre fin 2023 et fin 2024, les élus notent un manque d’homogénéité selon les catégories socio-professionnelles. Certaines directions, telles que le marketing, les ressources humaines, le commercial et l’assistanat continuent de subir des réductions d’effectifs.
Les taux de départ sont en diminution, notamment en ce qui concerne les démissions et les ruptures conventionnelles. Cependant, on observe une augmentation sensible des départs durant la période d’essai, pour les CDI comme pour les alternants, et des taux significativement plus élevés dans certains métiers comme le commercial (4,6%) ou le marketing (6,9%).
Le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) est également en baisse, lié au non-remplacement des absences et à un recours accru aux prestataires externes, notamment à la DSID dans le cadre du projet de plateformisation.
Alternants
Le taux d’alternants a fortement augmenté en raison d’une politique volontariste du groupe, en lien avec les Contrats d’Objectifs et de Moyens, avec un objectif cible à 6%. Le taux actuel est de 4,4%. Toutefois, les élus regrettent l’absence d’objectif de titularisation.
En 2024, 28% des alternants arrivant en fin de contrat ont poursuivi leur parcours au sein du groupe, dont 31 embauches en CDI, 3 en CDD. D’autres ont vu leur contrat d’alternance prolongé, mais ces chiffres restent modestes au regard du potentiel du dispositif
A peine 8,4 % des contrats d’alternance se sont transformés en CDI. Cette faible transformation soulève des doutes quant à la l’engagement du groupe en matière d’intégration durable des jeunes.
Les élus alertent sur le lien entre la réduction des CDD et l’augmentation des contrats d’alternance. Bien que ce lien ne semble pas être une stratégie officielle, il est observé concrètement sur le terrain. La part d’alternance est plus élevée dans les métier Marketing et communication (40% des effectifs), secrétariat et assistance (35%), alors que dans ces directions les effectifs (CDI) reculent.
Cela soulève le risque d’une utilisation économique progressive du dispositif.
Une partie croissante des contrats d’alternance sont rompus en cours de route (23% en 2024 contre 15% en 2021), rupture à mettre en relation avec le taux de départ des salariés en CDI pendant leur période d’essai. Ce phénomène pourrait être mis en parallèle avec le taux de départ des salariés en CDI durant leur période d’essai, phénomène qui devrait être analysé plus finement.
Nous demandons que soient définis lors de la renégociation de l’accord GAPEC en 2026 :
- Un taux maximum d’alternants par unité (par exemple 10%) afin de garantir une capacité d’accompagnement suffisante et préserver la qualité des parcours.
- Un objectif chiffré de transformation en CDI, en complément de l’objectif d’accueil.
La sous-traitance
Un niveau globalement élevé de sous-traitance a été atteint avec près de 1000 ETP (Equivalent Temps Plein) hors épargne.
Ceci interroge sur la stratégie de l’entreprise concernant ses activités « cœur de métier ».
Toutefois, un mouvement de reflux est constaté par les élus, en particulier en retraite complémentaire.
Le recours à la sous-traitance reste motivé par le besoin de renfort opérationnel, pour absorber les fluctuations de charge de travail.
Hormis à la DSID, le niveau de sous-traitance à court terme (2025/2026) devrait se stabiliser, voire diminuer, selon les activités, grâce à des stratégies de ré-internalisation des compétences. Ces stratégies sont notamment consécutives à la suspension du projet de transfert du recouvrement retraite complémentaire vers les URSSAF. Une vigilance accrue s’impose quant aux effets de ces transformations sur l’organisation du travail.
En revanche, nous alertons sur la croissance très significative du recours à la TMA (Tierce Maintenance Applicative) au sein de la DSID. Cette évolution pourrait fragiliser les compétences internes et réduire le contrôle sur des applications jugées stratégiques.
Focus sur l’emploi dans la retraite complémentaire
À la suite notamment de la suspension du projet de transfert du recouvrement retraite complémentaire vers les URSSAF, les recrutements ont été fortement intensifiés en 2024 (remplacements, mobilités et création de postes, particuliers et entreprises).
413 postes ont été pourvus en 2024 sur les 458 prévus, soit un taux de réalisation du plan de recrutement de 91%. Parmi ces recrutements, 194 sont des créations de postes. La phase d’intégration et de formation des nouveaux entrants a été renforcée, avec une journée d’intégration, un nouveau parcours métier et l’appui de formateurs relais.
La progression concerne majoritairement la catégorie des employés soit un total de + 215 cdi depuis fin 2021 représentant une hausse de 17%.
Les agents de maîtrise, après un effectif en baisse en 2022 et 2023, retrouvent leur niveau de 2021 pour s’établir à 523 CDI à fin 2024. Parallèlement, le nombre de cadres est en chute depuis 2021 pour s’établir à 52 salariés fin 2024 (vs. 61 en 2021).
Fin 2024, la dynamique de recrutement a également pour effet de rajeunir la pyramide des âges :
La part des 40-44 est passée de 28% en 2021 à 15% en 2024. Les 50-54 ans représentent désormais 11% des effectifs contre 21% en 2021. Les 25-29 ans sont en forte progression, atteignant 17 % en 2024.
L’âge moyen se rajeunit passant de 42,2 ans en 2021 à 39,7 ans en 2024. 46% des CDI ont moins de 2 ans d’ancienneté en 2024 vs. 1% en 2021.
Ce rajeunissement amène une nouvelle dynamique positive et nous laisse espérer une pérennisation des activités paritaires pour l’avenir, favorable au groupe.
GAPEC
Nous reconnaissons les efforts engagés par le Groupe en matière de prospective métiers, avec 25 observatoires tenus entre le lancement de la démarche et mars 2025, et un enrichissement progressif des données partagées.
Un enjeu central est l’articulation des travaux d’observatoire, de projection d’effectifs et des plans de recrutement. Les élus constatent par exemple que la forte baisse de 41% entre 2016 et 2024 des effectifs des métiers commerciaux (assistantes, technico, CAE, MDE, MDP…) est en inadéquation avec les objectifs de l’entreprise. Il est essentiel d’établir un lien entre les effectifs et la stratégie de l’entreprise.
De plus, la mise à jour biennale des informations en observatoire des métiers s’avère insuffisante, alors que l’accord prévoit une fréquence annuelle. Ce décalage est d’autant plus problématique que la plateformisation entraine des transformations instantanées et profondes des compétences et des niveaux d’emplois, sans perspectives connues, ni présentées aux élus.
Lors des observatoires, certaines informations sur l’emploi, les compétences et l’évolution des métiers et le recours à la sous-traitance, sont présentées aux participants, alors qu’elles devraient faire l’objet d’informations au CSE, dont ce sont les prérogatives.
Les élus constatent également un décalage temporel entre la production des observatoires et l’élaboration des plans de recrutement annuels.
Les hypothèses de travail et les contextes évoluent rapidement, ce qui engendre une forme d’obsolescence des données. C’est pourquoi une actualisation plus régulière des observatoires est envisagée. Certaines données pourront être mises à jour plus fréquemment grâce à l’automatisation de requêtes, un objectif inscrit dans la feuille de route à horizon 2026.
Un enjeu d’amélioration réside dans la lisibilité et de la cohérence des éléments suivants : l’articulation des différentes sources et des acteurs impliqués dans les travaux de prospective, de projection d’emplois et d’élaboration des plans de recrutement. Il est important que les observatoires puissent identifier des trajectoires d’emploi à la baisse, tandis que les projections d’effectifs annuelles affichent une augmentation, et que les plans de recrutements permettent d’atteindre les besoins projetés.
L’articulation encore partielle des plans de recrutement et des prévisionnels d’effectifs, et l’obsolescence rapide des travaux des observatoires, due à des environnements particulièrement mouvants et peu prévisibles sont à corriger rapidement.
La direction propose de travailler au 2ème semestre sur les observatoires des métiers.
Une nouvelle croissance des effectifs est envisagée pour 2025, de l’ordre de 4% pour le groupe, avec des évolutions attendues à la hausse principalement sur la Direction de la Retraite Complémentaire, la Direction Distribution et Relation Client, le Secrétariat général, les équipes RH ou encore la Direction communication et cabinet.
Une projection de quasi-stabilité des effectifs est prévue à la DSID, ce qui peut surprendre au regard des enjeux de plateformisation, ainsi qu’au sein de la direction de la santé prévoyance. Pourtant, des volumes importants de besoins de recrutement sont exprimés à la DSID, ainsi qu’au sein de la Direction distribution et relation client ou encore de la Direction de la Retraite Complémentaire.
Nous attendons de l’acquisition de l’outil Workday une meilleure articulation entre les besoins métiers, les projections financières et les plans de recrutement et demandons une présentation détaillée de cet outil et de son intégration dans le processus global d’anticipation des besoins.
Formation
La formation connaît une progression globale, notamment en lien avec la forte dynamique de recrutement. Tous les indicateurs de formation montrent une progression de l’effort en 2024 : les dépenses de formation dépassent pour la première fois 5% de la masse salariale. Au sein de l’UES, 4 675 salariés ont bénéficié d’une action de formation en 2024, soit 92% de l’effectif CDI. Le taux d’accès est identique pour le GIE et l’IRC.
Le nombre de sessions de formation (+14,7%), le nombre de jours de formation (+9,3%), le nombre de personnes formées (+4,3%) et le nombre de stagiaires (+21,4%) progressent également. Notons également que la majorité des formations se déroulent désormais en e-learning. Il est important de conserver un équilibre entre les formations en présentiel / distanciel et les formations en ligne.
La progression se retrouve également sur des axes stratégiques, comme la cohésion, les soft skills ou le management (formations agilité, leadership, COMOP, Lean…). Le taux d’accès est élevé (92%) mais l’intensité reste limitée pour une partie des salariés, car 54% des actions de formation durent entre 0 et 1 heure au sein de l’UES.
92% des salariés ont bénéficié d’une action de formation en 2024, 15% entre 0 et 1h, et 29% moins de 8 heures.
En 2024, les dépenses de formation augmentent de 7% par rapport à 2023, soit +755k€. Cette évolution est portée majoritairement par la hausse de la rémunération des salariés formés, qui représentent le premier poste de dépenses (42%). Les dépenses « autres » augmentent également de façon significative (+48%). Les dépenses pédagogiques externes, (organismes de formation extérieurs) progressent de 5%, tandis que les dépenses pour les formations internes (formateurs internes et fonctionnement des locaux) reculent de 40%.
Lors de la présentation du bilan en Commission Politique Sociale, une distinction est faite entre le taux d’accès global à la formation et le taux d’accès hors formations obligatoires. Un écart a été relevé entre les données de la direction et celles présentées par l’expert, probablement lié à une différence dans les populations étudiées. Lorsque les formations obligatoires, notamment les modules courts de moins d’une heure, qui représentent une part significative de l’offre obligatoire, sont extraites, on obtient un taux d’accès à la formation de 85%.
Seniors
L’emploi des salariés seniors est un enjeu majeur au regard de la pyramide des âges : 479 salariés ont plus de 60 ans, soit 9% des salariés, et 1 391 salariés ont plus de 55 ans, soit 27% des salariés. Il est essentiel d’anticiper et d’accompagner les départs à la retraite, et d’organiser la transmission des savoirs, par exemple dans les métiers du commercial où 33% des salariés ont plus de 55 ans. Il est également important de dynamiser leurs parcours professionnels et de valoriser leurs savoir-faire, en tenant compte notamment d’un taux d’accès à la formation plus faible pour les plus de 55 ans et de la part accrue de salariés bénéficiant de moins d’un jour de formation par an.
Les salaires des seniors ont tendance à stagner en fin de carrière, étant globalement moins bénéficiaires des augmentations individuelles.
Le groupe risque de faire face à une perte massive d’expertise professionnelle technique, et ce dans toutes les filières, si elle ne met pas en œuvre rapidement un accord spécifique.
Les élus CFDT CFE-CGC CGT UNSA SUD-SOLIDAIRES souhaitent l’ouverture d’une négociation sur un accord ‘seniors’ d’ici la fin de l’année, voir début 2026.
La politique relative aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail
QVCT
La première année de déploiement de l’accord QVCT est en demi-teinte : elle a été centrée sur la construction des dispositifs, avec une déclinaison prévue au cours de la deuxième année. Le bilan réalisé un an après la signature de l’accord fait apparaître un axe sur les chantiers relatifs à la prévention des risques professionnels, à la prise en compte des Risques Psycho-Sociaux et à la constitution d’un réseau de secouristes en santé mentale. Les actions sont principalement axées sur la rédaction de cahiers des charges, la recherche de prestataires, la conception des dispositifs et la formation, ce qui les rend peu visibles pour les salariés et leurs représentants. Le décalage dans la mise en œuvre, par rapport au calendrier annexé à l’accord, peut également contribuer à un sentiment de retard.
Les élus regrettent que certains champs, comme l’appréciation des données d’absentéisme et la thématique des salariés aidants, apparaissent peu investis, voire pas du tout, malgré une mise en œuvre prévue dès début 2025.
L’absentéisme
L’analyse qualitative de l’absentéisme reste limitée, dans l’attente du démarrage effectif des travaux prévus dans le cadre de l’accord QVCT. Une certaine stabilité du niveau général est constatée, avec un léger repli de l’absentéisme maladie. Le niveau d’absentéisme, établi à 5,4%, tous motifs confondus, est stable en 2024 au périmètre de l’UES (-0,2 point).
Cependant, de légères variations apparaissent selon les motifs d’absence, notamment une hausse de la volumétrie des jours hors maladie ou accident du travail. Cette tendance n’a pas été identifiée, mais des pistes ont été évoquées concernant peut-être un meilleur niveau d’information des salariés sur leurs droits. Un léger retrait du niveau de l’absentéisme maladie est observé, dans un mouvement similaire à celui constaté par le baromètre Diot Siaci.
Une légère baisse de l’absentéisme maladie est liée essentiellement à des arrêts moins longs, mais les raisons de cette baisse restent à déterminer. L’origine se situe dans la diminution de la durée moyenne des arrêts, liée très largement aux durées moins longues des arrêts de plus de 180 jours.
Une attention particulière est portée sur certaines tranches d’ancienneté et certains métiers ayant vu leur niveau d’absentéisme fortement augmenter.
Sur les trois dernières années, un taux d’absentéisme plus élevé et une tendance à la hausse sont constatés pour les salariés ayant entre 5 et 15 ans d’ancienneté. Un lien avec le niveau d’engagement ou la dynamique professionnelle pourrait être étudié. Des taux en hausse sont également observés dans les métiers des RH, du secrétariat et de l’assistanat, ainsi qu’au sein de la DSID.
En parallèle de la légère diminution du nombre de jours d’absence maladie, une hausse (également modérée) est observée des jours de congés autorisés (congés exceptionnels, enfant malade, conjoint malade), des jours d’absence pour autre cause (congés sans solde < 1 mois) et des jours de congés maternité/paternité.
Nous considérons comme prioritaire l’engagement du chantier relatif à la méthodologie d’analyse de l’absentéisme, qui permettrait de mieux comprendre les causes de ces évolutions et de cibler les actions de prévention.
Sur la charge de travail, les indicateurs suivis ne font pas apparaître de dégradation globale qui auraient pu impacter l’absentéisme.
Toutefois, nous demandons :
- Un suivi plus fin par entité, métier et site ;
- Une attention particulière aux métiers de la DSID, en 2025 et jusqu’à la fin des projets de plateformisation, qui connaissent une hausse de l’absentéisme à contre-courant de la tendance générale.
Egalité professionnelle
Dans le secteur informatique, le groupe s’efforce d’atteindre un taux de féminisation des recrutements supérieur ou égal à celui des principales filières de formations informatiques. Les femmes restent majoritaires dans l’entreprise (environ 71% de l’effectif total). Les recrutements en CDI dans le métier informatique sont composés à 24,1% de femmes, contre 24,2% l’année précédente. En 2024, les femmes représentent 18,6% des effectifs dans le métier informatique contre 17,9% en 2023 et 71,6% dans des mobilités internes.
Le groupe déploie des formations et des sensibilisations à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les stéréotypes. En 2024, 570 personnes ont participé à ces initiatives, contre 157 en 2023.
Un effort important est fait pour sensibiliser les managers à la diversité et à l’égalité professionnelle, mais il est encore insuffisant.
Un des objectifs de l’accord d’entreprise est de faire progresser la part des femmes à des postes à responsabilité et à des fonctions de direction. En 2024, les femmes sont, pour la première fois, majoritaires jusqu’à la classe 7.
L’objectif est également de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour autant, en 2024, l’écart de rémunération reste important, avec un salaire moyen inférieur de 27,2% pour les femmes. Cet écart est de 25,2% au niveau médian.
Chez les cadres, le différentiel de rémunération entre les femmes et les hommes passe de -14,1% en 2022 à -12% en 2024, mais toujours bien présent et non négligeable.
Une attention particulière, en plus des éléments ci-dessus, devrait être portée aux salariés à temps partiel et à leur accès à la formation, à la promotion et aux augmentations individuelles, cependant les élus constatent, encore et encore, que la rémunération des temps partiels évolue plus faiblement que les temps pleins.
La charge de travail
Les indicateurs sur la charge de travail manifestent une tendance générale à l’amélioration, mais ne doivent pas masquer l’existence de situations ciblées de déséquilibres. Une progression nette du taux de répondants lors des entretiens professionnels, estimant réussir à gérer la charge de travail (85%) et un taux de satisfaction particulièrement élevé sur la capacité à équilibrer la vie privée et la vie professionnelle (89%) sont notés.
Il apparaît nécessaire de conduire une analyse des caractéristiques des répondants ayant estimé ne pas réussir à gérer la charge et/ou ne parvenant pas à concilier la vie professionnelle avec la sphère privée, en tenant compte du métier, de l’ancienneté et de la fonction managériale.
Sur une population d’environ 8 800 salariés au niveau groupe, 155 (soit 2%) ont répondu « non » à la question « Votre charge de travail est-elle adaptée à votre temps de travail et vous permet-elle un équilibre satisfaisant entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle ? ». Même si cette proportion est limitée, son augmentation par rapport à 2023 peut être notée. Une suite apparaît en revanche majoritairement donnée aux situations de surcharge manifestées.
Un volume global d’heures supplémentaires et de salariés concernés est en baisse en 2024. Au sein de l’IRC, les heures supplémentaires sont réparties sur une part importante de salariés (soit en moyenne moins de 10h sup/an par salarié). Au sein du GIE en revanche, même si le volume total d’heures supplémentaires est en baisse, il apparaît de plus en plus concentré sur un nombre limité de salariés, notamment dans la direction santé prévoyance et dans la direction investissement, finance et risques.
La persistance d’un nombre important d’heures supplémentaires, même en baisse, soulève des questions quant à la charge de travail des directions concernées.
Une analyse est nécessaire pour déterminer si la baisse de ces heures supplémentaires est due à une diminution de la volonté des employés de faire des heures supplémentaires ou à une réduction effective des besoins.
La politique salariale
Un travail d’anticipation des impacts de la directive sur la transparence des rémunérations a été confié à un cabinet externe. Cette directive, qui devra être transposée en droit national avant juin 2026, emportera des obligations substantielles pour les entreprises et entraînera des changements profonds sur la politique de rémunération et la communication des niveaux de rémunération.
Nous demandons :
- Un engagement rapide des chantiers liés à cette directive,
- Un partage d’informations précoce avec les représentants du personnel sur le contenu de la directive, les chantiers identifiés, le calendrier et la méthode de travail.
L’enveloppe consacrée aux mesures collectives octroyées à l’ensemble des salariés (hors Comadir et étant présent au 31/12/2023 depuis 18 mois d’ancienneté) de l’UES augmente (+436k€), bénéficiant à 4 553 personnes dont 4 531 en CDI, pour un montant moyen annuel brut de 390€ (contre 655€ en moyenne en 2023).
L’enveloppe des augmentations individuelles est en retrait par rapport à 2023 (-4%). Cependant, le nombre de bénéficiaires (d’au moins une augmentation individuelle) a augmenté de +13% (2 420 en 2024 contre 2 149 en 2023). Le montant du budget de la prime de partage de la valeur ajoutée est en baisse de 639k.
Le montant global des primes commerciales reste relativement stable, tandis que le montant global des primes exceptionnelles recule à nouveau à 2 468k€ (soit -11% par rapport à 2023).
Focus CRC
Le salaire moyen des CRC accueil a connu une progression plus forte pour les nouveaux embauchés, due à l’augmentation globale du salaire d’embauche en 2023. Cependant, cette situation réduit l’écart avec les salariés expérimentés, ce qui pose alors la question de la reconnaissance des compétences.
Notons que la grande majorité des conseillers, retraite comme assurantiel, reste en classe 2. Le métier à pourtant grandement évolué sur ces dernières années, exigeant aujourd’hui une réelle technicité, une forte expertise et une grande agilité, compte tenu des missions et des attentes accrues.
La question de la pesée des emplois se pose également pour ce métier en profond changement, y compris dans le cadre du renouvellement de l’accord d’entreprise sur les CRC qui doit être renégocié en fin d’année.
Conclusion
Les élus soulignent en conclusion avec satisfaction la hausse des effectifs pour la deuxième année consécutive, ainsi que l’effort de formation.Les perspectives 2025/2026 incluent une croissance des effectifs de +4%, un reflux de la sous-traitance et la renégociation de l’accord GAPEC.
Nous notons cependant la faible transformation des contrats d’alternance en CDI, une augmentation des départs en période d’essai qui peux inquiéter si elle n’est pas approfondie, les disparités d’accès aux formations, le retard dans le déploiement de certains chantiers QVCT, notamment la question de l’absentéisme et des aidants.
En faveur des négociations programmées au premier semestre 2026 sur l’accord GAPEC, les points suivants pourraient être envisagés :
- Un encadrement du recours à l’alternance par unité (famille de métier) afin de réduire les risques d’une insuffisance de ressources pour accueillir et accompagner les salariés dans leurs activités (par exemple, un taux maximum de 10% par unité).
- Un objectif de titularisation des salariés en alternance à échéance de leur contrat, en complément de l’objectif de taux d’accueil d’alternants affiché par le groupe.
Comme le recours à l’alternance, les modalités d’accueil et d’intégration des nouveaux entrants pourraient trouver leur place dans le prochain accord GAPEC. La négociation peut en effet porter sur la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, les perspectives de développement et les modalités d’accueil de l’alternance et des stagiaires.
Un autre enjeu central pour l’avenir est l’articulation des travaux d’observatoire, de projection d’effectifs et des plans de recrutement. Il est essentiel d’établir un lien clair entre les effectifs et la stratégie de l’entreprise.
Le recrutement en retraite complémentaire sur 2025 prévoit 341 postes (304 à la base), en majorité des remplacements de départs, essentiellement en relation client, action sociale et postes de RAC (Responsable Amélioration Continue). Compte tenu de ce fort renouvellement, l’enjeu porte sur la capacité de la retraite complémentaire et au-delà du groupe à offrir des perspectives d’évolution à ces nombreux salariés ayant rejoint récemment le groupe. À titre d’illustration, en 2025, 232 salariés de la RC (soit 9% des effectifs) ont exprimé un besoin de mobilité vers des postes plus transverses (pilotage, processus, chargés d’étude) ou vers le management ou encore l’action sociale.
La sous-traitance représente aujourd’hui au global près de 1000 ETP hors épargne. Ceci interroge sur la stratégie de l’entreprise concernant ses activités cœur de métier.
Enfin, comme chaque année, concernant l’égalité professionnelle, une attention particulière devrait être portée pour supprimer les différentiels de rémunérations et de versement des primes entre les femmes et les hommes, mais également entre les temps pleins et les temps partiels.
Un travail d’anticipation des impacts de la directive sur la transparence des rémunérations a été confié à un cabinet externe. Cette directive, qui devra être transposée en droit national avant juin 2026, emportera des obligations pour les entreprises et entraînera des changements profonds sur la politique de rémunération et la communication des niveaux de rémunération.
Nous demandons :
- Un engagement rapide des chantiers liés à cette directive
- Un partage d’information précoce avec les représentants du personnel sur le contenu de la directive, les chantiers identifiés, le calendrier et la méthode de travail
Afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise et de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, il est recommandé d’élever le salaire d’embauche. Cette mesure viserait à assurer l’attractivité de l’entreprise, à fidéliser les employés et à garantir un niveau de rémunération en adéquation avec les standards du marché. L’implémentation de cet ajustement salarial contribuerait à renforcer la motivation des équipes et à améliorer la performance globale.
Les élus CFDT CFE-CGC CGT UNSA SUD-SOLIDAIRES demandent également qu’une négociation sur les seniors et la fin de carrière soit ouverte d’ici la fin de l’année, voir début 2026.
Les métiers changent, évolue, se transforment : les fiches emplois évoluent, pour autant la pesée des emplois n’est pas réalisée, ou alors sans concertation avec les élus.
Les élus CFDT CFE-CGC CGT UNSA SUD-SOLIDAIRES demandent donc qu’une commission de négociation mixte paritaire soit créée pour la pesée des emplois dans les meilleurs délais.